Vulgarisation et extériorisation des savoirs : entre amertume et frustration (2)
Publié par Hélène Biton, le 3 septembre 2021 810
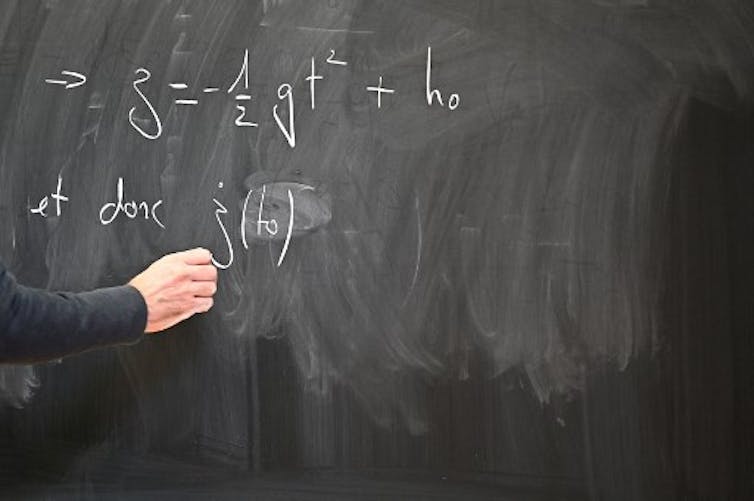
Arnaud Mercier, Auteurs historiques The Conversation France
Comme nous l’avons vu, un grand enthousiasme rejaillit des témoignages laissés par les chercheurs qui ont massivement participé à notre étude en ligne (4 480 réponses) sur l’extériorisation et la vulgarisation des savoirs.
Pourtant cela ne doit pas masquer qu’au-delà des rares réticences à toute forme d’action de ce type dans notre panel (« J’ai autre chose à faire dans mon métier de plus sérieux que de me mettre en scène ») des opinions critiques s’expriment. Elles doivent nous alerter sur le sentiment de malaise que peuvent ressentir les scientifiques français. Ils et elles justifient alors leur participation à ces dispositifs en adoptant une posture défensive, soulignant notamment la nécessité de défendre l’image de disciplines ou de la science en général qu’ils perçoivent comme menacée, déformée. Le rôle des médias (haut lieu de vulgarisation) est en conséquence mis en cause, souvent sévèrement.
S’y ajoutent de nombreuses frustrations liées au fait qu’ils et elles se considèrent soumis à des formes d’injonctions contradictoires par leurs tutelles (du ministère aux présidences d’université ou directions d’organismes de recherche), rendant difficile leur engagement dans des activités que pourtant tous approuvent.
On retrouve donc les trois derniers mots-clés de notre liste liminaire : posture défensive, contrebalancement et frustration.
Une posture défensive…
Des réponses aux questions comme des témoignages, il ressort que certains scientifiques vivent leur discipline comme en danger, comme méconnue, comme boudée, comme stéréotypée. La participation à des dispositifs hors les murs est donc vécue comme un acte de réhabilitation, une façon de modifier la perception de la figure du scientifique, la mauvaise image d’une science, de la faire connaître quand la discipline est jugée rare ou peu visible. Ils et elles agissent donc pour « donner une vision plus juste d’un domaine », « dissiper les inquiétudes et les fantasmes concernant le domaine », « montrer la réalité d’un laboratoire de recherches au plus grand nombre de citoyens », « démystifier certaines croyances (sur les pratiques scientifiques mais aussi certaines découvertes) ».
Aller au-devant des publics est donc une façon de leur ouvrir les portes des laboratoires pour leur montrer la réalité des choses. C’est ce que nous dit ce chimiste : « je constate que la chimie et une science mal aimée du public. Je trouve cela dommage et injuste, et souhaite, à travers mon activité de vulgarisation de mes propres travaux (et des autres), démontrer que la chimie est une science utile et moderne, dont les objectifs sont écologiques et louables ».
De nombreux témoignages accumulés ressort l’idée qu’aller à la rencontre de divers publics non académiques est une contribution à l’amélioration de l’image des sciences, 54 % considèrent comme très importante la motivation « valoriser l’image d’une discipline », 38 % comme assez importante. Extérioriser ses savoirs c’est donc participer à une réhabilitation. Et les combats sont divers. Il peut s’agir de « désacraliser la science et ses aspects anxiogènes », « de gommer les peurs qui y sont associées », de montrer « qu’il y a des femmes scientifiques », « que la recherche est essentielle dans ce pays », « de valoriser le bien-fondé de la recherche fondamentale ».
On ressent parfois une forme d’amertume, un sentiment d’incompréhension qui oblige les chercheurs à se mobiliser pour briser les murs d’indifférences. La science hors les murs se veut une reconquête des cœurs : « essayer de faire connaitre les sujets de recherche dits “inutiles” afin d’attirer l’attention du public et du ministère et donc des financements ». Il faut s’employer pour attester que « la recherche scientifique est au service de la population/la société ». Il faut savoir, nous dit cet enseignant en sciences sociales de Saint-Étienne, « convaincre les “élites” à la tête de l’État que les universitaires peuvent être une aide et une partie prenante importante à la prise de décision ». « Je veux défendre l’existence de la recherche publique et des disciplines rares comme la mienne » écrit une chercheuse lyonnaise en sciences humaines. Autant de propos qui indiquent que la science doit se battre pour se justifier et faire connaître une utilité qui va pourtant de soi aux yeux des chercheurs.
Contrebalancement des médias
Le rôle des médias d’information comme médiateurs de connaissance est aussi source d’inquiétude et de motivation. 53,5 % des répondants jugent très important le désir de « ne pas laisser le monopole de la parole à des vulgarisateurs que vous jugez insuffisamment légitimes », 30 % assez important. D’ailleurs 1 079 sont tout à fait d’accord pour dire que « les médias pour le grand public ne sont pas adaptés à l’exposition des résultats des travaux de recherche », même si 367 de ceux-là ont néanmoins déjà accordé des interviews aux médias. Et au total parmi les 2 291 qui ont déjà été sollicités par des médias généralistes, seuls 127 ont décliné (seulement 5,5 % donc).
Les médias sont décriés par certains de nos répondants. Ils n’ouvriraient pas assez leur colonne ou antenne à l’explication scientifique sérieuse : « les médias ne sont pas prêts à partager les connaissances, ils ne prennent pas le temps ». Et ce d’autant moins qu’ils sont une fabrique au consentement social, comprendre à la docilité. « Le grand public est nourri aux médias débiles qui fabriquent leur consentement ». « Une grande partie des médias populaires favorise la paupérisation intellectuelle ». 33 % des répondants ont d’ailleurs peur que « leurs travaux soient dénaturés » dans des actions de vulgarisation.
En termes fleuris, égratignant notre enquête au passage, un chercheur en sciences sociales tourangeau s’écrie : « votre étude est débile car vous n’avez pas compris que si on ne nous voit pas c’est que l’élite autoproclamée des journalistes (piliers de bars de la bêtise ambiante et de l’inculture crasse) qui a pris le dessus ». L’exercice médiatique reste donc une forme d’extériorisation clivante suscitant un fort ressentiment car il contraint à « répondre à des questions profondément débiles d’un journaliste avec la culture scientifique d’un pois chiche » se désole un enseignant en sciences sociales parisien. De façon générale, le risque de participer à une discussion avec enjeux scientifiques dans une arène non académique est de se trouver mis sur un pied d’égalité inacceptable avec des discours considérés par le chercheur comme illégitimes. « Quand on oppose systématiquement à un argument scientifique un argument de pseudo-science, en leur donnant la même importance, ceci n’est pas un débat, c’est du spectacle » se lamente un chercheur alsacien en sciences des milieux naturels.
Cette vision des choses conduit donc des chercheurs soit à refuser l’extériorisation par voie médiatique, soit les motive à intervenir dans la cité dans d’autres arènes, pour rétablir des vérités scientifiques malmenées par la grande machinerie vulgarisatrice que sont les médias d’information.
La frustration
Ce tour d’horizon des perceptions de l’extériorisation des savoirs dans notre enquête serait incomplet si elle ne s’achevait pas par un focus sur les frustrations que la situation génère.
Ainsi 2402 chercheurs ayant répondu au questionnaire considèrent qu’ils n’ont pas le temps pour l’extériorisation des savoirs, dont 2025 répondent pourtant que « oui bien sûr, il est souhaitable que des travaux scientifiques soient partagés avec le plus grand nombre ». C’est assez dire que la pression temporelle qui pèse sur les chercheurs leur procure un sentiment de frustration, obligés qu’ils sont à réduire leurs ambitions de démocratisation du savoir.
Dans leur verbatim, cela ressort nettement. Il y a celles et ceux qui se désolent que cela prenne du temps alors que la pression à la production est forte et réduit leur temps disponible à faire autre chose que leur strict cœur de mission. « il est très difficile de trouver le temps pour cela en plus de tout le reste. Et pourtant nous le faisons ». Où on devine les possibles frustrations.
Surtout que d’autres soulignent, un peu amers, que cette pratique d’extériorisation n’est pas assez ou pas du tout valorisée dans leur carrière, lors des évaluations individuelles auxquelles sont régulièrement soumis les enseignants-chercheurs. « La vulgarisation pourrait nuire à ma carrière car elle n’est pour l’heure que peu reconnue sur le plan scientifique ». « Je le fais toutefois moins qu’avant car ce type d’interventions n’est absolument pas valorisé. Il est stratégiquement beaucoup plus intéressant de rester dans le champ académique » déplore une enseignante en sciences humaines lyonnaise. Ces activités sont perçues comme « chronophages », « c’est très prenant en temps, en énergie ». Or les chercheurs souffrent d’un « cruel manque de temps », d’une « faible valorisation de ces activités dans la carrière (des articles, des articles, des articles… dans des revues classées) ». Un sentiment d’accumulation des tâches souvent jugées indues et de non-valorisation d’autres plus utiles finit donc par irriter et doucher l’enthousiasme des chercheurs.
S’y ajoute un regard sceptique sur les aptitudes à se lancer dans l’exercice. 3292 répondants pensent que les chercheurs ne sont pas bien formés à vulgariser. Pourtant 87 % de ceux-ci pensent qu’il est très important de partager la connaissance avec le plus grand nombre, et 64,5 % d’entre eux ont déjà répondu favorablement à une sollicitation extérieure dans les trois dernières années. Au total 75 % de ceux qui ont déjà extériorisé leurs savoirs estiment pourtant que les chercheurs ne sont pas bien formés à l’exercice. Voilà pourquoi des commentaires critiques sont exprimés. On y dénonce ce qui ressemble fort à des injonctions contradictoires. Injonctions insupportables car elles heurtent le sentiment personnel de devoir et de plaisir, au risque d’en faire une corvée.
« Je pense utile et souhaitable de transmettre au plus grand nombre, et de manière accessible, mes recherches. Ce qui est insupportable, c’est l’injonction systématique à le faire » s’écrie une enseignante en sciences humaines rennaise. « Étant donné que les injonctions que nous recevons de nos instances induisent une perte de sens et de valeurs de ce métier, il ne m’apparaît pas pertinent de partager avec le public des découvertes qui ne présentent que peu d’intérêt » déplore amère une chercheuse en sciences de la vie de Montpellier, à qui ont a fait perdre la foi.
Injonction contradictoire car « les conditions de travail particulièrement détériorées et la faible reconnaissance des activités de démocratisation du point de vue des critères d’évaluation ne favorisent aucunement ce type de démarche ». « Il faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait et croire qu’on peut tout faire à l’infini sans augmenter notre salaire, sans nous accorder des décharges d’enseignement, sans valoriser ces activités qui ne relèvent ni de la recherche ni de l’enseignement ! » Pour autant, aucune revendication n’émerge pour être rémunéré pour ce genre d’action. Au contraire, la démocratisation des savoirs demeure valorisée comme un don de soi : face à l’affirmation « il ne faut accepter ces sollicitations que si elles sont rémunérées » seuls 3 % répondent « tout à fait ».
À la question pourquoi n’avoir pas pratiqué ces activités jusque-là, parmi les 1383 concernés, les explications se répartissent ainsi :

Voilà pourquoi trouve à s’exprimer l’idée qu’il faudrait étendre le recours à des spécialistes de la vulgarisation dédiés à cette mission pour soulager les chercheurs qui n’en peuvent plus : « Ce travail de vulgarisation est à faire mais doit être fait par des personnes spécifiques dont leur travail serait la promotion de la recherche. Le enseignants-chercheurs ne peuvent pas être en train de gérer des projets de recherche, faire de l’enseignement, gérer les tâches administratives et en plus faire la promotion de la recherche ».
Qu’en conclure ?
À l’issue de cette enquête nul doute qu’une réflexion serait à mener pour voir à quelles conditions cette activité, en plus, pourrait être mieux valorisée au moment des évaluations individuelles afin de mieux accompagner un élan solidement ancré chez une grande majorité des enseignants-chercheurs. Élan qui sert à « augmenter (voire rétablir) la confiance entre Science et Société » dit l’un d’eux. Accompagnement qui doit passer notamment par des actions de formation, des ateliers pratiques, puisque les trois-quarts des chercheurs admettent qu’ils sont mal formés à l’exercice.

Arnaud Mercier, Professeur en Information-Communication à l’Institut Français de presse (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Auteurs historiques The Conversation France
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.





