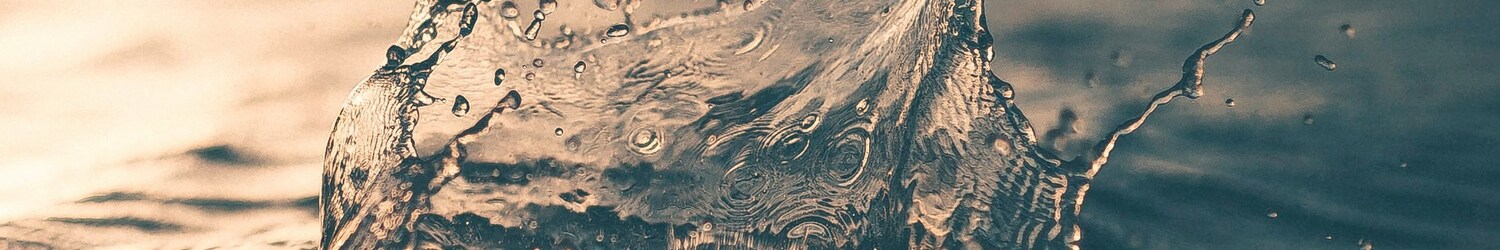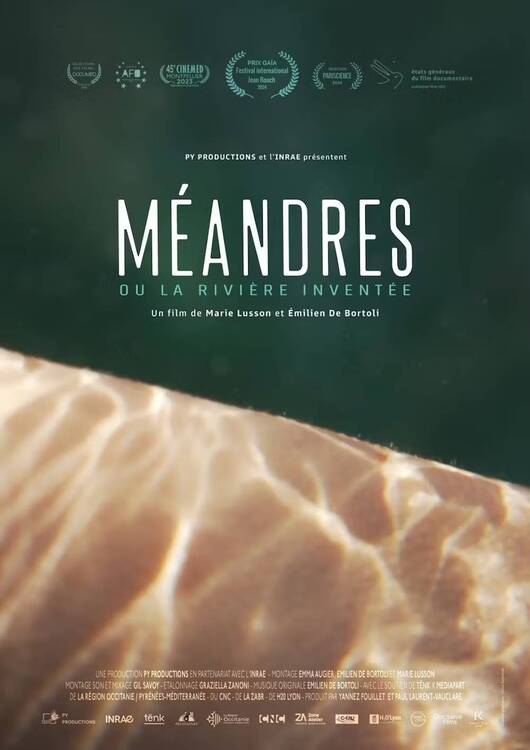Marie Lusson a consacré une thèse ainsi qu’un film documentaire à la question des rivières. Au-delà des enjeux scientifiques, techniques et sociopolitiques liés à la restauration des cours d’eau, le film documentaire Méandres ou la rivière inventée invite à refaire monde avec les rivières, ses usagers et ses habitants – tant humains que non humains.
Pour accompagner cet article, nous vous proposons d’accéder gratuitement au film en VOD pendant dix jours (utiliser le mot de passe THECONVERSATION25).
Le Vistre était à l’origine une rivière de plaine marécageuse qui s’écoulait au sud de Nîmes, de Bezouce à Mauguio. Dès le XIIe siècle, les marais sont desséchés et son cours est dévié. En 1774, drainages et dragages viennent lui assigner un lit fixe favorable à la navigation jusqu’à Aigues-Mortes. Les opérations de canalisation se succèdent ainsi jusqu’aux années 1950, où son cours large et profond permet alors d’évacuer rapidement les eaux pluviales et usées. Le Vistre modifié devient peu à peu un cloaque. Ses riverains se détournent de lui – et se plaignent de ses débordements destructeurs.
Ce point de départ est à la fois celui de la thèse de Marie Lusson (dirigée par Florian Charvolin et Christelle Gramaglia, soutenue en 2021) et du film documentaire Méandres ou la rivière inventée, coréalisé par Emilien de Bortoli et Marie Lusson en 2023.
Dans la thèse, il s’agissait d’exposer de manière critique la trajectoire sociohistorique de quatre rivières du sud-est de la France promises à une restauration pour rendre compte des controverses qui, dans certains cas, limitent les actions de réparation, et dans d’autres, font hésiter entre des travaux de terrassement lourds ou une mise en retrait pour redonner leurs espaces de divagation aux rivières.
Pour autant, le film déborde de la simple répétition illustrée de ce travail de recherche. Il vise avant tout la traduction à l’image de méthodes et concepts de sociologie inspirés par Bruno Latour. Il livre une expérience composite qui relève tout à la fois de l’œuvre d’auteur et du documentaire scientifique.
Des rivières devenues machines
Selon l’historien américain Richard White, qui s’est penché sur la trajectoire de la rivière Columbia, les travaux d’aménagement ont pour conséquence de désassembler les cours d’eau et leurs plaines alluviales pour les mettre au travail.
Beaucoup de rivières, comme le Vistre, sont ainsi devenues des « machines organiques » qui ne fonctionnent plus comme des écosystèmes, mais comme empilement d’entités appréhendées séparément, sur un mode dégradé.
Ces aménagements, qu’il s’agisse d’ouvrages hydroélectriques ou de digues, ont eu pour effet de corseter, fixer et inciser le lit des rivières, tandis que des rejets industriels et urbains dégradaient la qualité de l’eau. Leur profitabilité a toutefois été entamée lorsque l’artificialisation a commencé à générer des conséquences inattendues. Les écosystèmes aquatiques, réduits à l’état de machines organiques, se sont mis à dysfonctionner.
Des proliférations biologiques peuvent survenir. En certaines occasions, les cours d’eau sortent également des lits qui leur ont été assignés, provoquant des destructions d’autant plus importantes que des constructions ont été faites dans leurs plaines alluviales.
Les agriculteurs ont, de leur côté, drainé leurs champs ou pompé de l’eau. Les producteurs d’électricité s’en sont servi pour actionner leurs turbines. Les propriétaires de bateaux de commerce et de plaisance ne se sont plus préoccupés que des niveaux d’eau. Jusqu’aux pêcheurs qui ne se sont plus intéressés qu’à certaines espèces de poissons. Chacun s’est concentré sur une fonction, un service ou une ressource avec la même logique extractiviste, sans se soucier des autres ni de la santé des milieux concernés.
À force, l’accumulation des aménagements, prélèvements et rejets a conduit à la diminution des aménités habituellement tirées des rivières.
Des politiques de restauration encore trop technocentrées
D’autres conséquences indirectes sont à relever :
- Les liens de dépendance qu’entretenaient nos sociétés avec les cours d’eau pour leurs besoins fondamentaux (boisson, irrigation, hygiène et production énergétique) ont été défaits.
- Les ouvrages de protection ont éloigné certaines rivières de la vue et endormi la vigilance des riverains.
C’est pourquoi de nouvelles politiques de restauration ont été lancées, telle la Directive-cadre européenne sur l’eau de 2000 transcrite en droit français en 2006. Elles entendent remédier à la dégradation des milieux aquatiques comme cela a pu être fait pour le Vistre.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
La plupart des initiatives dans ce domaine restent toutefois très technocentrées et descendantes. Les professionnels ne convergent pas toujours sur les options à privilégier.
Plus encore, les projets techniques sont élaborés entre gestionnaires et bureaux d’études, indépendamment des habitants. Les controverses sont souvent vives et conduisent, dans les trois quarts des cas, à l’abandon des projets – surtout quand le portage politique fait défaut.
Une médiation artistique inspirée par Bruno Latour
Comment contribuer à l’émergence de projets de restauration qui ne fassent pas fi des controverses, mais au contraire apprennent d’elles pour explorer des pistes de récupération collective ? Les travaux du socioanthropologue des sciences et des techniques Bruno Latour ont ouvert des pistes fertiles.
Depuis ses premières recherches sociologiques sur l’acteur-réseau jusqu’à ses plus récents essais de philosophie sur le nouveau régime climatique (2015) et ses expérimentations artistiques et scientifiques sur la zone critique (2020), il s’est intéressé aux pratiques et aux productions des chercheurs et à leurs effets sur le monde, avant d’entamer un dialogue avec des artistes pour trouver des réponses à la crise écologique.
Il a notamment questionné la manière dont ceux qu’il appelle les « Modernes », ont cherché à s’émanciper d’une nature pensée comme extériorité et reléguée – dans le meilleur des cas – à l’état de décor. Ses recherches ont grandement contribué à renouveler les collaborations scientifiques et les médiations artistiques pour sortir de l’impuissance.
On citera, parmi ceux qu’il a inspirés, l’historienne d’art Estelle Zhong Megual et l’historienne et metteuse en scène Frédérique Ait-Touati, qui se sont penchées sur l’influence de la peinture et du théâtre sur nos perceptions de la nature, trop souvent réduite à l’état d’objet passif. Méandres hérite de cette réflexion collective.
Symétries entre humains et non-humains
Méandres est une œuvre composite qui doit grandement aux collaborations engagées par sa réalisatrice Marie Lusson avec :
- son co-réalisateur, Émilien De Bortoli, artiste vidéaste et musicien,
- les scientifiques, issus de plusieurs disciplines des sciences de la terre et de la vie et des sciences sociales de l’Inrae et de l’Université de Lyon,
- les professionnels du documentaire créatif qu’elle a pu croiser lors de sa formation à l’école documentaire de Lussas.
Ce caractère multiple, qui a pu donner lieu à des tiraillements, est devenu au fur et à mesure une marque de fabrique et une force. Le film relève tout à la fois de l’œuvre d’auteur et du documentaire scientifique. Il montre plusieurs chercheurs et ingénieurs au travail – mais aussi une activiste engagée au chevet de sa rivière.
Il s’attarde également sur des êtres bien plus petits et régulièrement oubliés des réflexions sur le devenir des rivières : les galets, les sédiments, les débris de matière organique, les macro-invertébrés et les poissons les moins nobles qui les peuplent.

Le choix de traitement de l’image, qui s’inscrit dans la lignée des productions riches du Sensory Ethnography Lab de l’Université de Harvard, tel le film Leviathan sur la pêche hauturière, opère des effets de symétrisation entre des échelles très différentes.
Ainsi, l’œil de l’écologue est placé à la même échelle (par l’utilisation d’un objectif macro) que les organismes qu’elle observe. De même, des séquences sous-marines, des plans ralentis et des cadrages inhabituels, suivent les frémissements des larves et le déplacement de graviers.
Le film se présente comme connecteur et assembleur de réalités plurielles. La rivière elle-même est montrée comme agencement. Elle est une et plusieurs, mais surtout pleine des êtres qui l’habitent tout autant qu’ils la façonnent. Parmi eux, les non-humains, très souvent oubliés. Il est proposé au spectateur d’adopter momentanément leur point de vue d’une manière à la fois intelligible et sensible.
En cela, ce travail fait écho à des recherches en cours sur le rôle des castors dans le stockage de l’eau ou encore à des réflexions sur les droits des fleuves.
Les scientifiques y sont d’ailleurs traités d’une manière nouvelle : ils ne délivrent pas un discours d’autorité qui imposerait un diagnostic et des solutions. Ils se présentent, eux aussi, avec leurs fragilités et incertitudes, pris dans un entrelacs de relations et préoccupations. Ils ne sont ni nommés ni rattachés à une institution. L’image alterne entre de très gros plans sur leurs visages et leurs mains, et d’autres plans plus larges où, par exemple, un hydrologue acousticien disparaît dans la masse des rochers qui l’entourent.
Ces effets de zoom et dézoom sont pensés pour opérer des rapports de symétrie entre humains et non-humains, quelle que soit leur taille ou leur force. Il en est de même entre professionnels qualifiés et riverains. Ce n’est pas un hasard que le film se termine sur le visage d’une activiste qui explique son engagement en faveur du ruisseau des Aygalades, particulièrement abîmé par l’industrie et la ville, à Marseille.
La caméra nous propose de regarder sur le même plan des entités hétérogènes. L’objectif est de compenser, au moins momentanément, des inégalités, pour libérer les imaginaires et puissances d’agir. De fait, c’est presque une fiction qui nous est proposée pour engager la réflexion sur la restauration des rivières et les médiations indispensables à son succès.
L’autorité des scientifiques n’en est pas pour autant niée, mais elle est placée au même niveau que d’autres perspectives et expériences.
Les séquences dédiées à la descente de la rivière en radeau, qui constituent le fil rouge du film, apportent des contrepoints incarnés. Les jeunes gens embarqués dans cette aventure à la fois ludique et éprouvante, nous convient à ressentir la rivière : les niveaux et la force de l’eau selon le linéaire, les obstacles, le caractère glissant du substrat et les conditions météorologiques. L’alternance de moments joyeux et méditatifs ou le spectacle d’une peau qui se froisse sous l’influence du froid, renvoient les spectateurs à leurs propres souvenirs où l’enfance et ses jeux d’eau sont convoqués.
Enfin, le montage est construit de façon à créer des basculements fluides pour mêler le scientifique au poétique. Cette étape de montage a d’ailleurs été extrêmement longue, six semaines, témoignant de cette difficile cohabitation des registres.
Il en découle un film complexe dans lequel la voix off nous invite à nous interroger sur ce qui fait une rivière et sur les conséquences de nos choix. Elle n’a cependant pas vocation à démontrer ou dénoncer. Elle invite plutôt à la précaution, à l’hésitation et au tâtonnement collectif, pour éviter les erreurs du passé et définir des futurs plus favorables.
À quels êtres et dépendances devrions-nous faire attention pour refaire monde avec nos rivières et plus largement avec l’eau qui vient à nous manquer ? Méandres a non seulement touché un public large dans le cadre de festivals documentaires, mais il est encore régulièrement utilisé lors d’ateliers participatifs destinés à faciliter l’implication des riverains de cours d’eau abîmés dans la co-construction de projets de restauration écologiquement et socialement ambitieux.
Les auteures remercient leurs collègues Maria Alp et Sylvie Morardet (Inrae), mais aussi Béatrice Maurines et Oldrich Navratil (Université de Lyon) qui se sont impliqués dans l’écriture du film. Elles saluent tout particulièrement l’implication de Yannez Fouillet, de PY productions, pour son indéfectible soutien. Sans elle, Méandres n’aurait pas eu le même retentissement.
![]()
Marie Lusson, Cinéaste, docteure en sociologie des sciences à l'Inrae, Inrae et Christelle Gramaglia, Sociologue des sciences de l'environnement, Inrae
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.